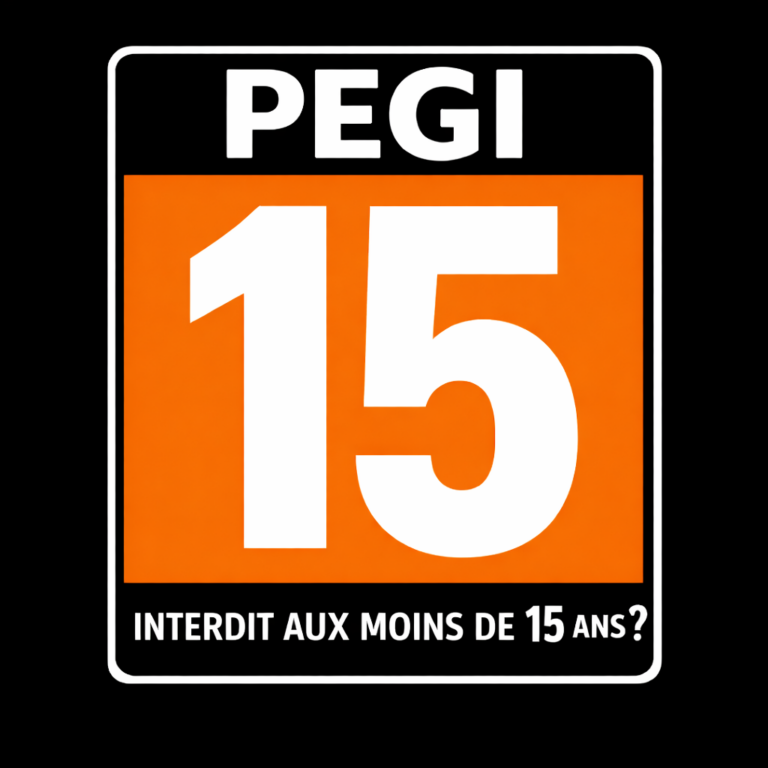La série Adolescence, succès planétaire de Netflix, nous plonge au cœur du meurtre d’une jeune femme par un adolescent sous l’influence de mouvements masculinistes. Au-delà de la qualité de la série, que nous recommandons vivement, cette intrigue soulève une question essentielle : comment la pop culture participe-t-elle à façonner les représentations de la masculinité ?
Depuis les années 1980, que ce soit à travers le cinéma, les jeux vidéo ou les médias, ces figures masculines ont souvent été idéalisées ou stéréotypées. Mais leur évolution a aussi été marquée par l’émergence de certains discours sur Internet et leur appropriation par diverses mouvances politiques. Aujourd’hui, ces représentations dépassent le simple cadre culturel et nourrissent des débats de société majeurs.
Table des matières
Du nouvel Hollywood au retour du biceps
Les années 60 et 70 ont été marquées par la libération des mœurs et l’évolution des mentalités. Au même moment, le monde du cinéma européen a connu un nouveau courant de films moins chers à produire mais plus réalistes et moins stéréotypés. C’est la Nouvelle Vague, avec des réalisateurs comme Jean-Luc Godard ou encore François Truffaut. Elle inspire les américains, et c’est alors la période dite du Nouvel Hollywood. Pourtant à la fin des années 70 – début 80, Hollywood revient à des productions de type blockbusters, généralement à plus gros budget, avec une histoire plus conventionnelle, construite sur le modèle du monomythe.
Proposé par Joseph Campbell dans son ouvrage Le héros aux mille et un visages, il explique que les récits de beaucoup de contes, histoires et films sont en fait des dérivés du même archétype de récit, le monomythe. Il s’agit d’un récit universel d’un voyage qui se décompose en un certain nombre d’étapes.
Mais en plus de la dimension blockbusters formatés, cette vague cinématographique se caractérise également par un retour à un modèle masculiniste. Celui-ci se veut une réponse à l’angoisse de disparition du patriarcat et du mythe du guerrier, entre autres mis à mal par la guerre du Vietnam et l’évolution sociétale de l’époque. Ainsi, on verra dans ces années-là l’émergence de figures imposantes comme Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger et Jean-Claude Van Damme, accompagnés d’autres modèles de virilité comme Bruce Willis ou Harrison Ford. Même si le cinéma de cette époque ne se résume pas qu’à ça, l’homme blanc hétérosexuel macho qui domine la « pauvre demoiselle en détresse » est une figure très présente. Le jeu vidéo lui emboite d’ailleurs le pas, et les princesses Peach et Zelda sont encore très passives dans cette décennie.
Virilité et castration
Cette peur ayant entrainé un retour du masculinisme exacerbé renvoie à ce qui est nommée en psychanalyse angoisse de castration. Pour faire (très) simple, lorsque le jeune garçon découvre le corps féminin, il pense qu’elles « n’ont pas de sexe », et a alors l’angoisse d’être privé du sien, notamment en cas de transgression de l’interdit œdipien. Si cette période œdipienne est mal résolue, l’angoisse peut ressurgir et le mécanisme pour s’en défendre prendra la forme de la protestation virile. Il s’agit d’une surenchère dans la virilité stéréotypée, notamment par la musculature et la domination de la femme. Or la virilité n’étant définie que par les cultures, elle est donc un idéal qui est, de par sa nature, inaccessible.
En parallèle du retour d’une virilité au tour de biceps de Rocky et Terminator, on observe un retour du conservatisme, de la suprématie et du patriotisme américain.
Rocky part en quête de la toute-puissance nommée « phallique » en psychanalyse : le titre de champion du monde des poids lourds en boxe anglaise, métaphore de la quête rêvée d’une puissance renouvelée par les États-Unis. Même s’il perd contre le champion dans un premier temps, le désir de revanche de l’homme blanc fait que l’étalon italien bat l’afro-américain Apollo Creed à la fin du deuxième opus. Dans la réalité, la boxe anglaise est un sport dominé par des figures afro-américaines connues comme Mohammed Ali, Sugar Ray Robinson ou le polémique Mike Tyson etc. Pourtant, dans l’imaginaire de ceux qui ne pratiquent pas ce sport, Rocky en est une icône. Au point que la statue de Rocky Balboa (et non pas Sylvester Stallone) qu’on voit dans le troisième film est réellement située au pied du Philadelphia Museum of Art.

De l’uchronie
Cette réécriture de l’histoire d’un sport, voire de la place des États-Unis dans le monde, est une uchronie : un récit d’évènement fictif prenant un point de départ historique réel. Ce procédé est courant dans la littérature ou la pop-culture, comme Le Maître du Haut Château de Philip K. Dick (et son adaptation en série), ou encore Wolfenstein: The New Order.
Ce qui questionne ici, c’est l’influence que la pop-culture exerce sur les membres de la société dont elle est issue. En effet, cette uchronie dépasse le cadre du cinéma et impacte les mentalités. Ainsi l’homme blanc américain musclé qui finit toujours vainqueur devient une figure de premier ordre pour une partie de cette génération.
En plus d’un message sociétal, cette période cinématographique est parfois accompagnée d’un message politique qui, lui aussi, influence ceux qui y sont soumis.
Le premier Rambo pose un questionnement sur les vétérans du Vietnam, mais Rambo y retourne dans le deuxième volet, comme pour effacer la défaite dans une réécriture symbolique de l’histoire. Idem pour Rocky IV, où l’américain bat le géant russe dénué d’émotion. Le discours quasi-parodique qui conclut le film annonce, sans le vouloir, la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin. La fiction a un impact sur la réalité politique, ou du moins l’a précédée dans ce cas.

Rappelons que les présidents Ronal Reagan (USA) ou Volodymyr Zelensky (Ukraine) étaient des acteurs avant leurs carrières politiques, tout comme l’ex-gouverneur Schwarzenegger.
Vers une évolution des représentations
Malgré une tentative de maintien des films à héros musclés dans les années 90, les blockbusters ont commencé à muter, les super pouvoirs ont souvent pris le pas sur la musculature. Les femmes ont commencé à devenir moins passives, le jeu vidéo a évolué à l’unisson, avec les premières figures fortes et autonomes comme Chun-Li (Street Fighter) ou Lara Croft (Tomb Raider). Cependant, force est de constater qu’elles sont encore très sexualisées. Il faudra attendre 2013 pour que Lara revienne avec une apparence plus réaliste, tout comme Ellie dans the Last of us (2013) ou encore Maxine dans Life is strange (2015).
Le cinéma, les séries et les jeux vidéo se sont voulus plus inclusifs, peut-être comme une réponse culturelle à la période précédente ? Les minorités en termes d’origines ethniques, d’orientations sexuelles et de genres sont devenues plus visibles à l’écran. Cependant, ce mouvement qualifié de « woke » a fait grincer certaines dents, le terme « wokisme » devenant fréquemment péjoratif. On a par exemple observé un certain rejet de la nouvelle orientation inclusive de Disney, comme nous l’avions évoqué dans notre article sur la petite sirène.
Le retour du masculinisme ?
Parallèlement à cette évolution, grossissait plus ou moins dans l’ombre une certaine forme de masculinisme, s’appuyant sur l’évolution des outils numériques. De forums de discussions aux vidéos d’influenceurs, cette manosphère prétend « réveiller » les hommes qui se seraient laissés convaincre par un discours sociétal féministe.
Le féminisme est tout simplement une revendication de l’égalité en droits des genres. De ce fait, « We Should All Be Feminists » comme le dit l’autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Mais pour ces « mascus », c’est plutôt une menace, synonyme de perte de virilité. On a ici à faire à une réelle angoisse de castration, le mot est d’ailleurs employé tel quel dans certaines vidéos. Les hommes seraient ainsi « dé-masculinisés », féminisés, il faudrait les guider vers un retour aux « origines », à des figures paternelles plus traditionnelles, mais dans leurs plus mauvaises dimensions.
Car ce discours, suivi et relayé pas des personnes se nommant parfois « incels » (pour célibataires involontaires) ou encore mgtow (« Men Going Their Own Way »), est un pur discours de haine envers la femme, qui flirte parfois avec les idées extrémistes.
C’est d’ailleurs étonnant de voir que la métaphore de la « red pill » de Matrix a été reprise par ce mouvement mais complètement inversée en un message de rejet de l’autre. Dans le film, la pilule rouge choisie par Neo symbolise sa prise de conscience que sa réalité n’est que fictive et qu’il souhaite s’éveiller au monde réel. Il s’agit ici d’une métaphore de la sortie du capitalisme mais aussi de l’identité de genre, les Wachowski étaient alors en pleine réflexion quant à leur transition. Lilly Wachowski n’a d’ailleurs pas hésité à exprimer son mécontentement de ce détournement de symbole.

De plus, cette mouvance mascu est habilement exploitée par des personnes sans scrupules qui n’hésitent pas à utiliser la souffrance psychique d’hommes mal dans leurs vies, à des fins notamment financières car, pour devenir un « vrai homme », il faut payer des abonnements, des formations, des livres, des stages dans la nature etc.
Certes, les formations qui vendent du vide sont légion sur Internet : pour monter un business et devenir millionnaire en quelques jours, pour perdre des dizaines de kilos sans rien faire (ou en prendre autant en musculature, c’est au choix) etc. Sauf que bien que ces escroqueries exploitent le mal-être de personnes en souffrance, elles n’appellent pas à la haine comme ces discours misogynes.
Avec un langage souvent populaire, ne s’appuyant naturellement sur aucune base scientifique mais seulement sur la prétendue expérience d’une seule personne, les femmes sont réduites à quelques caractéristiques, et un comportement stéréotypé permettrait donc de les « soumettre ». Un prêt à penser pour pallier une souffrance qu’un travail thérapeutique aurait pu soulager. Ce type de discours réducteur haineux n’est pas sans rappeler celui à destination de certaines minorités ethniques, religieuses, sexuelles etc. Si Internet peut porter une parole de savoir et de partage, il est malheureusement aussi un facilitateur pour tout ce genre de discours.
Le reportage « Mascus, les hommes qui détestent les femmes » de Pierre Gault nous plonge au cœur du phénomène.
Ce triste mouvement aurait pu s’évanouir dans les méandres des serveurs avec le temps, pourtant, il semble aujourd’hui que les plus hauts placés se fassent porte-paroles de valeurs réactionnaires et misogynes.
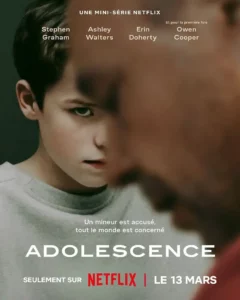
Politique et technologie porteuses de discours.
En effet, on assiste aujourd’hui à un retour du masculinisme et son corollaire guerrier et nationaliste. Dans le coin rouge, un Vladimir se montrant torse nu à cheval pour envahir son voisin. Dans le coin étoilé, un milliardaire qui assume d’effacer tout ce qui est en rapport à la question de genre et d’orientation sexuelle, dans une logique guerrière. Au milieu, le représentant des trois couleurs montre le biceps en s’affichant en boxeur, quand il ne parle pas de « réarmement ».
Le monde de la tech se fait écho de ce mouvement. Ainsi, on assiste aux soutiens publics en faveur de Trump de Mark Zuckerberg (Meta) qui souhaite davantage d’« énergie masculine » et également d’Elon Musk (X), ouvertement anti-woke et transphobe.
En dehors du fait que leurs positionnements aient un impact sur le plan politique américain et donc international, ils ont un énorme impact sur l’idéologie planétaire. Les réseaux sociaux sont devenus un support majeur d’informations, de pensées et de confrontation d’idées d’une grande partie de la population mondiale, en lieu et place des médias traditionnels comme la télévision et la presse écrite.
Ce retour d’un discours viril, misogyne, homophobe et traditionaliste risque donc d’avoir un important retentissement sur notre culture mondiale, risquant de réorienter une partie de la population vers des mentalités qu’on pensait en voie d’extinction. Et avec elle, une augmentation des comportements de ségrégation de genre, voire de violence.
Comment résister ?
Comment se positionner face au renouveau de ces discours extrêmes et ces problématiques associées ?
Un des premiers axes est celui de l’éducation aux médias, qui est devenu une part indispensable de l’éducation des futurs citoyens. Esprit critique, principe de réponse raisonnée différée là où les réseaux appellent à la réponse émotionnelle immédiate, vérifications des sources, sensibilisation au cyberharcèlement etc. Naturellement, cela n’est qu’une partie de la réponse.
Par ailleurs, la répartition en catégories stéréotypées, réflexe humain pour gérer des concepts, prend aussi ses origines dans l’imaginaire familial. Bien avant la naissance, certains parents attachent une grande importance au genre de l’enfant. La chambre qui lui est destinée se pare ainsi parfois de bleu ou de rose, les vêtements et accessoires reflètent cette dichotomie, etc… Comment alors s’étonner de voir les enfants répondre à de telles attentes en préférant très tôt les objets, jouets et conduites culturellement associés à la norme de leur genre ?
Un autre axe primordial est l’éducation à l’égalité, à l’empathie, aux genres. Ce que certains gouvernements outre-Atlantique commencent à déconstruire, mais qui résiste encore en Europe. Ainsi, les jeunes générations seront guidées pour développer une autre forme de masculinité, et un positionnement féminin plus assumé, afin de favoriser le vivre ensemble.
Vous me trouvez utopique ? Peut-être, mais ce positionnement est possible parce ce que la société prend conscience depuis un certain temps que la souffrance et le mal-être psychique ne sont pas une fatalité. L’issue de ce mal-être n’est pas la haine de l’autre, le soin psychique et le mieux-être qui en résulte existent.
Je crois donc, naïvement peut-être, que chacun peut vivre un peu plus heureux. Ensemble.
Pour aller plus loin
En livre :
Rocky: La revanche rêvée des Blancs – Loïc Artiaga, 2021
Le Mythe de la virilité: Un piège pour les deux sexes – Olivia Gazalé, 2017
La Crise de la masculinité: Autopsie d’un mythe tenace – Francis Dupuis-Déri, 2022
Le héros aux mille et un visages – Joseph Campbell, 1949
En vidéo :
Arte – Mascus, les hommes qui détestent les femmes
Arte – Viril, la masculinité mise à mal